LETTER TO JEAN-HUBERT MARTIN
Hassan Musa, Letter published in the catalogue of the exhibition ‘Sharing Exoticism’, Lyon Biennial, September 2000
Lire en français
Back in 1999, as I was invited to participate to the exhibition "Sharing Exoticism", curated by Jean-Hubert Martin, during the 5th Contemporary Art Biennial in Lyon, I wrote this letter as a reply to the invitation. Eventually, the curators chose not to include my work, but published my letter in the introduction of the catalogue. Often understood as a refusal to participate, my letter was instead a necessary foreword to my participation.
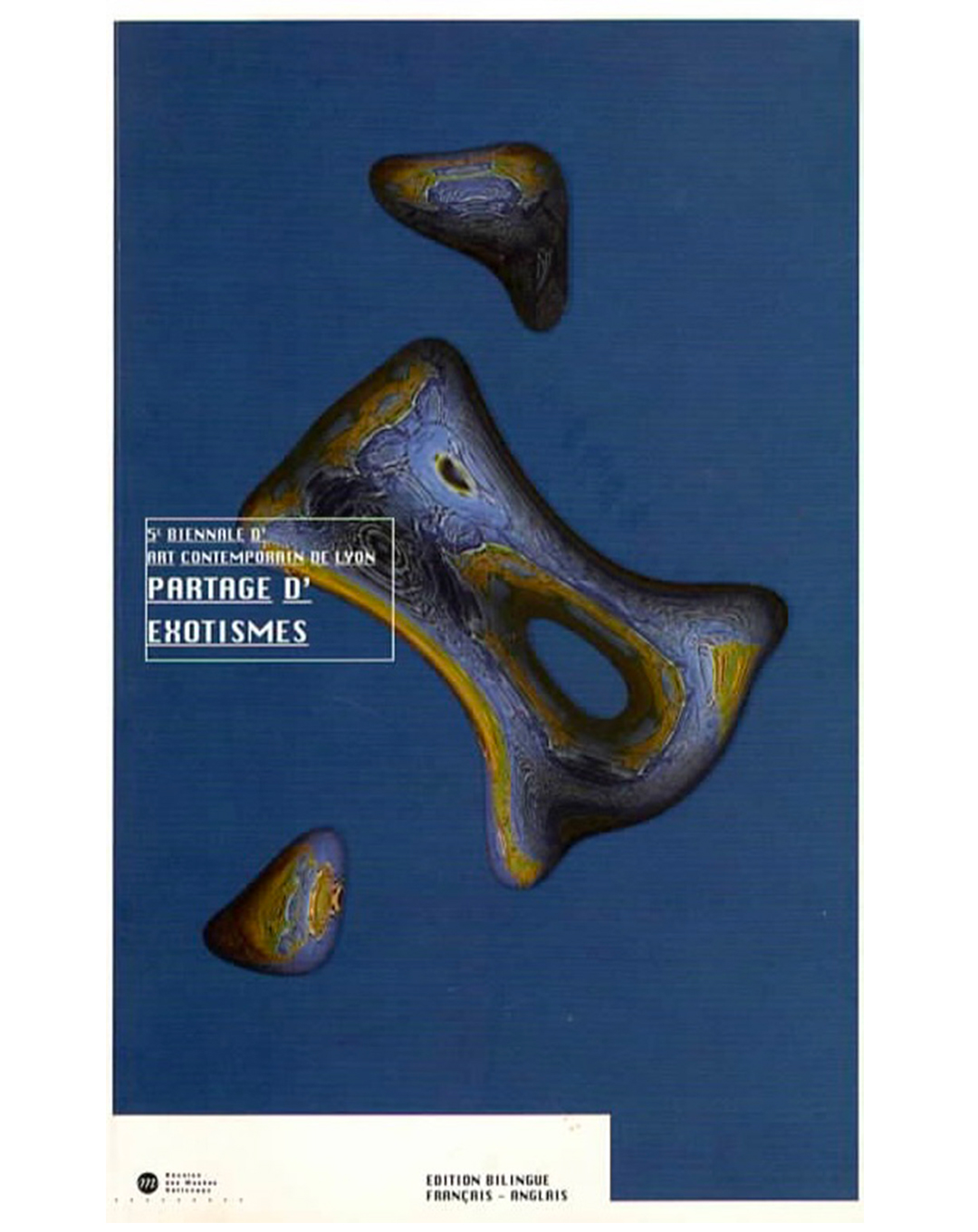
Domessargues 5 May 1999
Dear Jean-Hubert Martin,
Following your letter of March 1999, I am sending you some documents which include personal texts.
While going through these documents, a number of which date from the beginning of the 1990s, I noted that a good deal of what I was had to do with the phenomenon of African Art, though in fact my initial artistic intentions were very far removed from this domain.
My interest in African art may be related to the fact that I have lived in France for the last two decades. It has happened on numerous occasions that, as an artist, I have been reminded of my african origins, and of a certain image of Africa. I have been forced-me, an artist from Africa ! – to consider african art as a hindrance to my artistic projects rather than a favourable framework for their fulfilment. « But it’s your identity and your roots ! » protested a Jamaican friend who has always lived in London, when I suggested that there as no such thing as african art.
Today I sometimes say to myself : " All the better if my name appears in the files of this or that organiser of exhibitions of African Art. These few dozen people, spread out around the capitals of Europe, are in many cases members of international organisations, as well as being involved, in one way or another, in the presentation of extra-European artistic projects in the West. They represent the only possibility for African creative artists to show their art to the world. And there is « No problem » if the « African » artists concerned are in line with the norms of « art-Africanism », as long as it is their choice. But for myself, when I say that I do not agree with the norms, I risk being ignored – if not condemned – by the only institutions that could enable me to show my work.
African art is an enormous ethical misunrderstanding which I try to take advantage of without aggravating it ; but this leaves me with only a narrow margin for manœuvre.
Personally, as an artist born in Africa, but with no urge to bear the burden of the African Artist, I know that the only opportunities open to me to present my work in public outside Africa are of the « ethnic » type, where people assign to me the role of « the other African » in places designed for the kind of seasonal ritual where a certain kind of Africa is « in favour ». It is a situation which is not lacking in ambivalence, and which gives me the impression of being a hostage to this strange machine that integrates African-born artists into the world of art, while at the same time shunting them off into a category apart.
When I say that African artists do not constitute a category, this surprises European observers more than those of my artist friends who were born in Africa, perhaps because the latter do not recognise themselves as African artists other than in relation to Europe. Perhaps African art is not conceivable outside Europe, or perhaps « art-Africanism » is the only European category of art in which a place has been set aside for it.
Personally, as an artist born in Africa (now there’s a category ! ), I think that what is called contemporary African Art is just one of the possible evolutionary outgrowths of the European tradition, and that if, in our day, the artistic output of Africans is preferred to that of Eskimos or Amerindians, this is not a question of the artistic quality of African work, but of the circumstances surrounding the development of European aesthetic thinking. The day will come when European aesthetics turns from African Art towards other categories that more fully live up to its expectations.
What, then, are these expectations of European aesthetics that encourage Europeans to invent their own version of African art ? It is an African art that Africans never see, because it is often produced in Europe for these Europeans who collect it, exhibit it and make it an object of aesthetic reflection.
The main expectation of European aesthetics is ethical (we no longer have any concept of the sacred since we put Christ in a museum, as P. Gaudibert wrote, seeing in African art a huge reservoir of the sacred). The ethical allows men to define themselves in relation to themselves, to define the boundary between good and evil, an to set out norms of life, art, etc.
But if the European ethical obsession has focussed on Africa, this is perhaps because it was in Africa that Europeans behaved, and still behave, in a way that has been devoid of ethics.
So these troubled souls regularly indulge in the ritual of « washing the feet » of Africans at European artistic events where the African is enshrined as an artist with his credentials « in his blood » !
It is true that my name can be found in the files of people who organise exhibitions of African art, and that from time to time I am invited to participate in exhibitions of « art-Africanism ». I am happy enough about this, because such shows provide me a good way of sowing doubts about the foundations of « art-Africanism », at the risk of being « accepted » as « the African anti-artist » who kicks up a fuss within the walls of the Institution.
But I am optimistic, because the world is changing more and more rapidly, and because more and more people are becoming critical of the category of « African art ».
Hassan MUSA
LETTRE À JEAN-HUBERT MARTIN
Hassan Musa, Lettre publiée dans le catalogue de l’exposition « Partage d’exotisme » de la Biennale de Lyon, septembre 2000
Read in English
En 1999, lorsque j’ai été invité à participer à l’exposition « Partage d’exotisme », organisée par Jean-Hubert Martin dans le cadre de la 5ᵉ Biennale d’art contemporain de Lyon, j’ai rédigé cette lettre en réponse à l’invitation. Finalement, les commissaires ont choisi de ne pas inclure mon œuvre, mais ont publié ma lettre dans l’introduction du catalogue. Souvent perçue comme un refus de participer, ma lettre constituait en réalité un nécessaire préambule à ma participation.
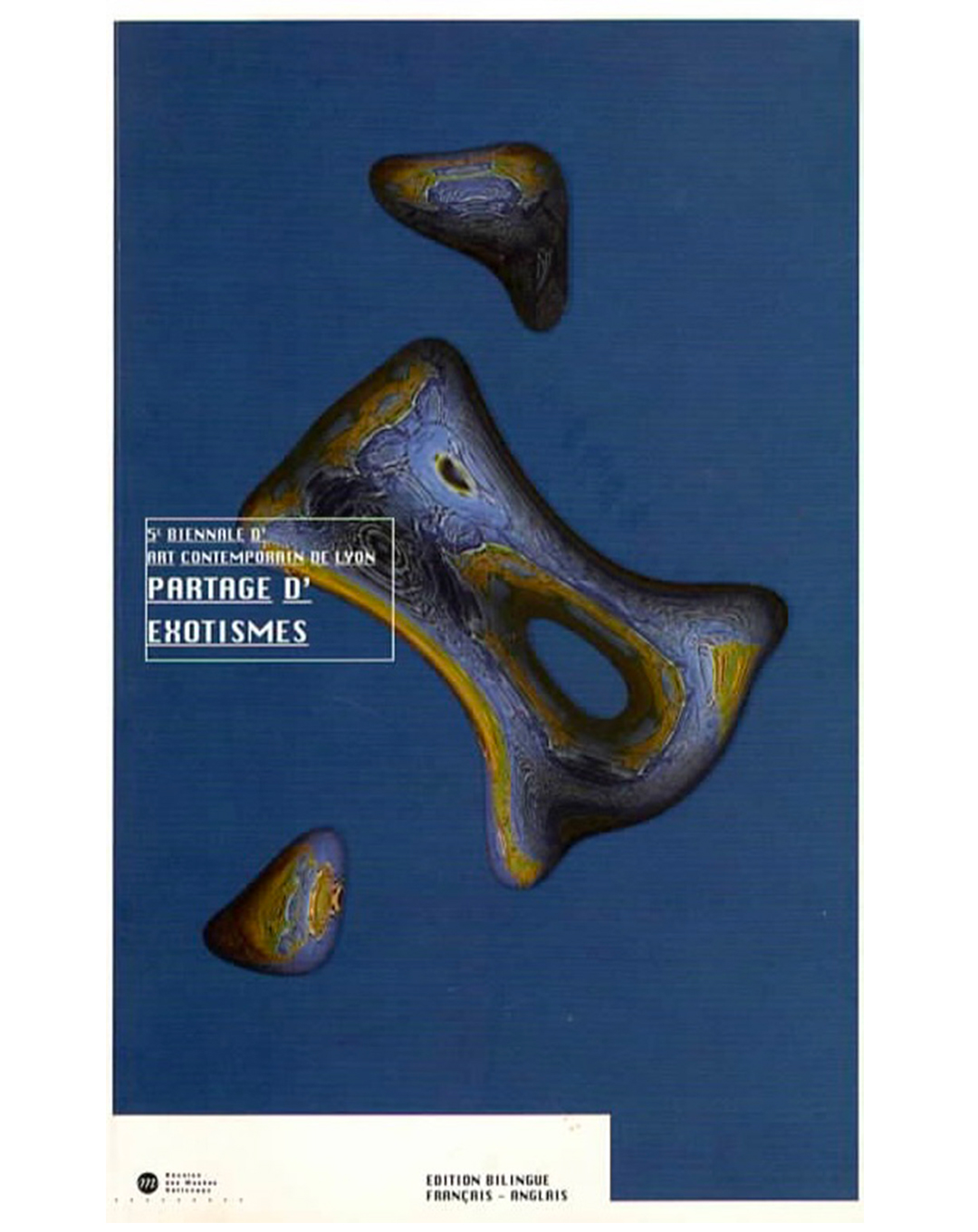
Domessargues le 05 /05/1999
Cher Jean-Hubert Martin,
Suite à votre lettre du 8 mars 1999, je vous envoie ci-joint, quelques documents comportant des textes personnels.
En parcourant ces documents dont certains remontent au début des années 90, je me suis aperçu qu’une partie considérable de mes propos traite du phénomène de l’art africain.
Pourtant mes intentions artistiques initiales étaient très éloignées de ce domaine. Peut-être que mon intérêt pour l’art africain est lié à mon séjour en France durant ces deux dernières décennies. Il m’est en effet arrivé de nombreuses fois, où en tant qu’artiste, on me renvoie à mes origines africaines et à une certaine image de l’Afrique. J’ai été contraint – moi, artiste venant d’Afrique ! – de considérer l’art africain plutôt comme une entrave à mes projets artistiques que comme un cadre propre à leur épanouissement. « C’est quand même ton identité et tes racines ! » s’indignait un ami jamaïcain qui a toujours résidé à Londres, à qui je disais qu’il n’y a pas d’art africain.
Aujourd’hui je me dis parfois que tant mieux si mon nom figure dans les fichiers de quelques organisateurs d’expositions d’art africain. Ces quelques dizaines de personnes dispersées dans les capitales européennes, souvent liées à des organismes internationaux, et impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans la présentation des productions artistiques extra-européennes en Occident, sont la seule possibilité pour les créateurs africains de montrer leur art au monde.
« No problem » si les artistes « africains » concernés sont en conformité avec les normes de l’art-africanisme du moment où il s’agit de leur choix, mais moi, quand je dis que je ne suis pas d’accord avec ces normes je risque de me trouver ignoré – voire maudit – par les seules institutions qui pourraient m’aider à montrer mon travail.
L’art africain est un grand malentendu éthique et j’essaie d’en profiter sans l’aggraver mais cela ne me laisse qu’une étroite marge de manœuvre. Moi, artiste né en Afrique, n’ayant aucun enthousiasme à porter le fardeau de l’artiste africain, je sais que les seules occasions qui m’ont permis de présenter mon travail au public, en dehors de l’Afrique, sont des occasions de type « ethnique » où d’autres m’attribuent le rôle de « l’autre africain » dans des lieux conçus pour ces rituels saisonniers où une certaine Afrique est « à l’honneur ».
Cette situation qui ne manque pas d’ambiguïté me donne l’impression d’être un otage de cette machine étrange qui intègre les artistes nés en Afrique dans le monde de l’Art tout en les excluant dans une catégorie à part.
Quand je dis que les artistes africains ne constituent pas une catégorie cela étonne davantage les observateurs européens que les amis artistes nes en Afrique, peut-être parce que les artistes nés en Afrique ne se reconnaissent comme artistes africains que par rapport à l’Europe . Peut-être que l’art africain n’est pas concevable en dehors de l’Europe ou peut-être que « l’art-africanisme » est la seule catégorie artistique européenne où une place leur est réservée.
Moi, artiste né en Afrique (ça c’est une catégorie !), je pense que ce qu’on appelle l’art africain contemporain n’est qu’une évolution possible de la tradition européenne, et que si, à notre époque, on favorise, la production artistique des Africains au lieu de celle des Esquimaux ou celle des Amérindiens, cela ne tient pas à la qualité artistique de cette production africaine mais plutôt aux circonstances de l’évolution de la pensée esthétique européenne. Le jour viendra où l’esthétique européenne tournera le dos à l’art africain pour d’autres catégories plus aptes à porter ses attentes.
Quelles sont donc ces attentes de l’esthétique européenne qui poussent les Européens à s’inventer leur propre art africain ? Un art africain que les Africains ne voient jamais car cet art est souvent produit en Europe pour les Européens qui le collectionnent, l’exposent et en font un objet de réflexion esthétique.
La principale attente de l’esthétique européenne est éthique, (nous n’avons plus de sacré depuis que nous avons mis le Christ au musée, écrit P. Gaudibert, qui voyait dans l’art africain une immense réserve du sacré). L’éthique permet aux hommes de se définir par rapport à eux-mêmes, de définir les limites entre le bien et le mal, de fixer les normes de la vie et de l’art etc.
Or si l’obsession éthique européenne se focalise sur l’Afrique c’est peut être parce que c’est en Afrique où les Européens se sont comportés, et se comportent encore aujourd’hui, de manière dénuée d’éthique.
Ainsi ces âmes troublées se livrent régulièrement au rituel du « lavement des pieds » des africains dans ces manifestations artistiques européennes où l’Africain est consacré artiste ayant son faire-valoir « dans le sang » !
Oui, mon nom figure dans les fichiers de quelques organisateurs d’expositions d’art africain, et on m’invite de temps en temps à participer à des manifestations « art-africanismes ». Je trouve ça plutôt bien car ces manifestations m’offrent une formidable plate-forme pour semer le doute sur les fondements de « l’art-africanisme » parmi les participants au risque de me faire « accepter » comme « l’anti-artiste africain » qui s’agite au sein de l’institution. Mais je suis optimiste car le monde change de plus en plus vite et de plus en plus de gens sont critiques à l’égard de la catégorie « art africain ».
Hassan Musa

